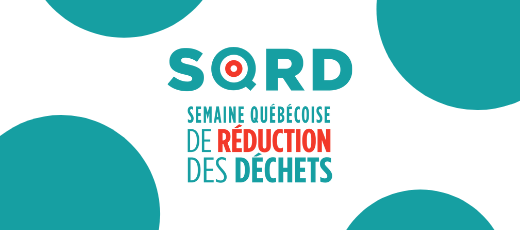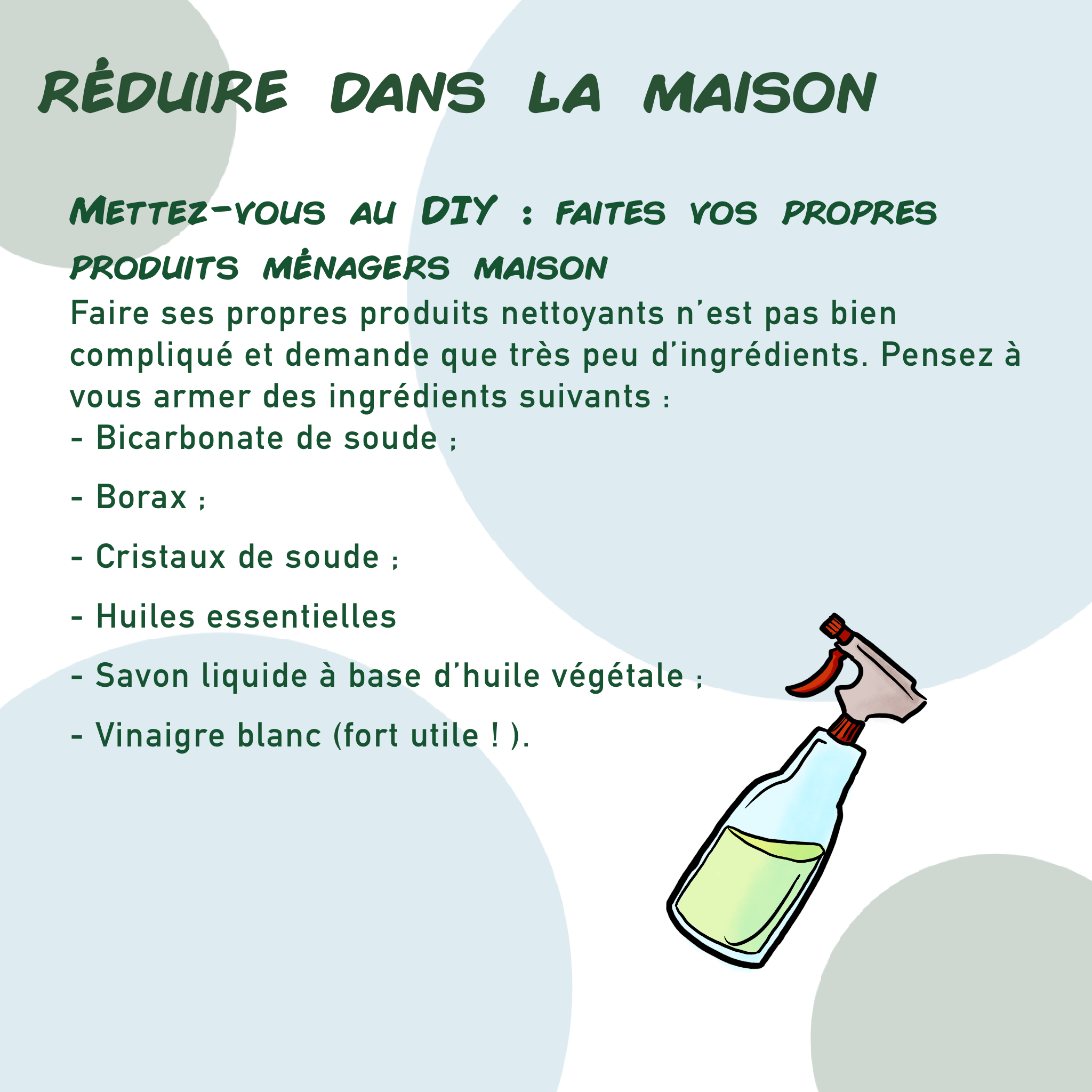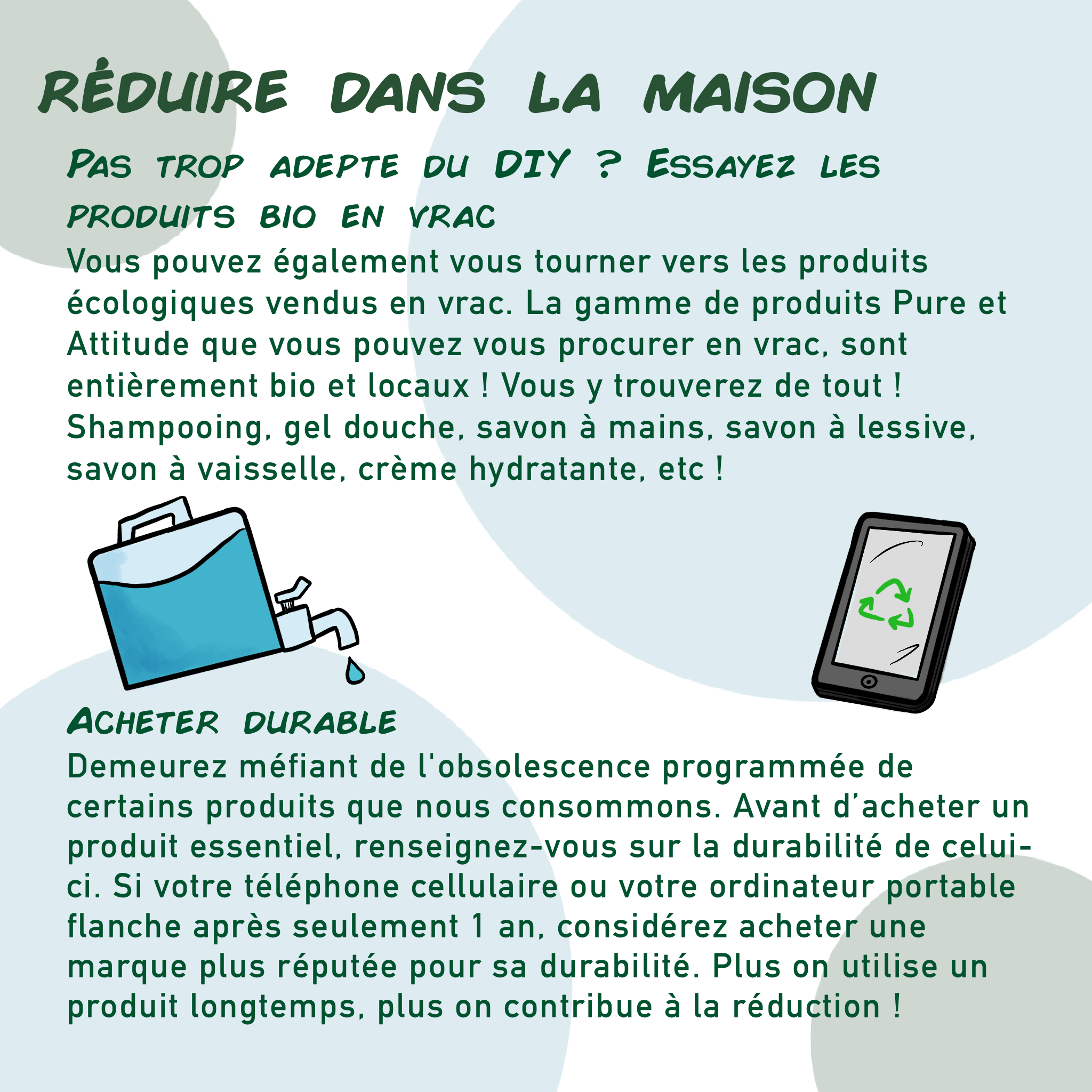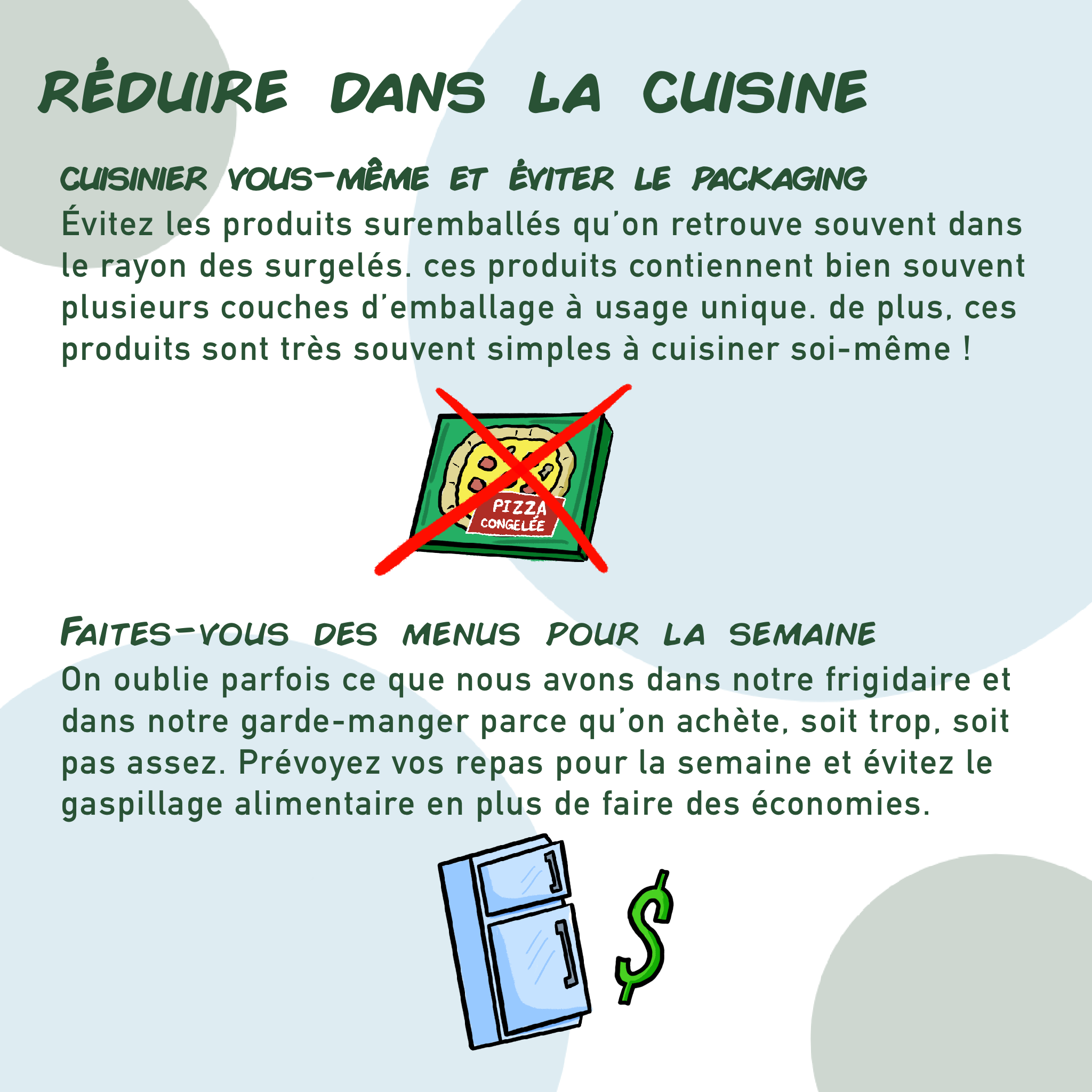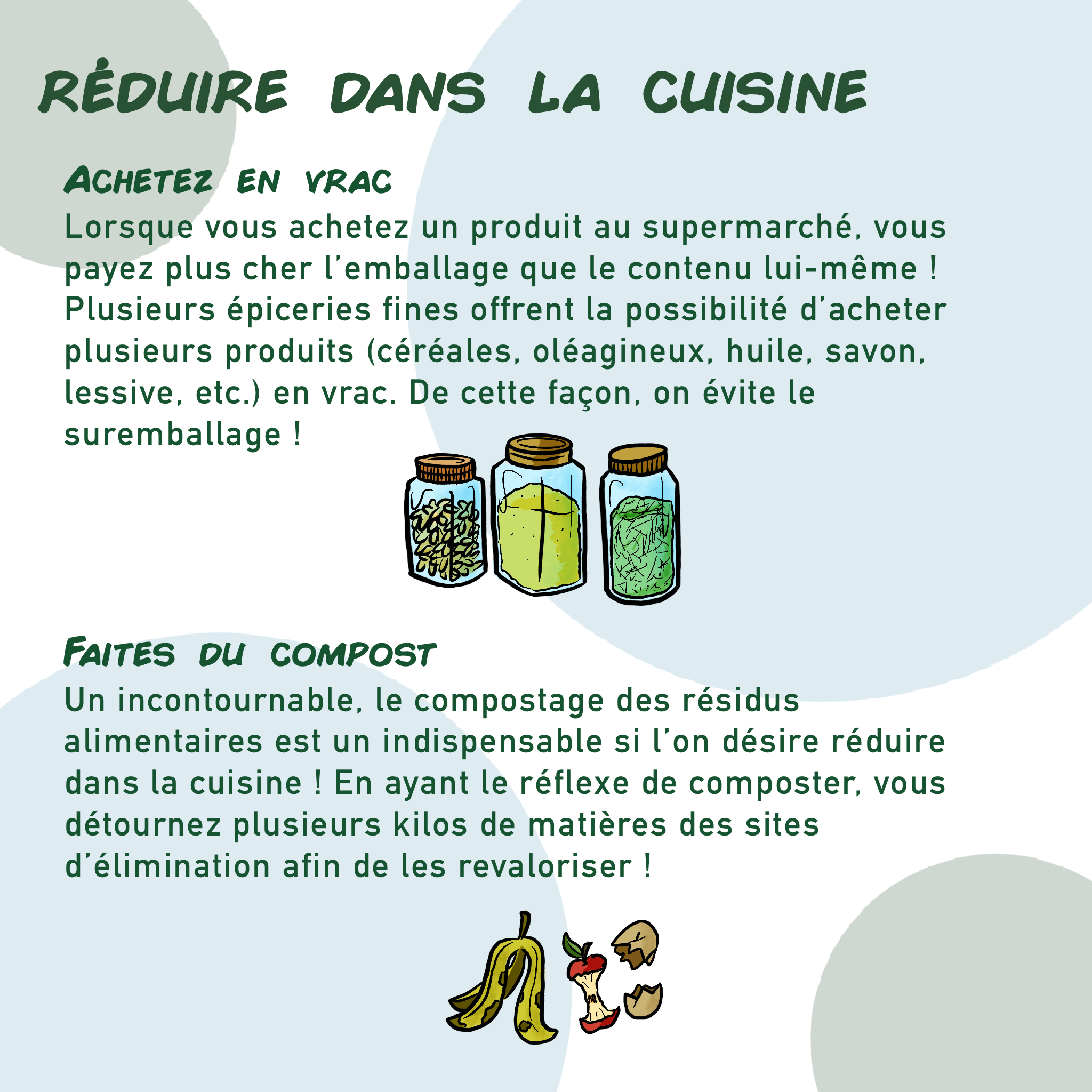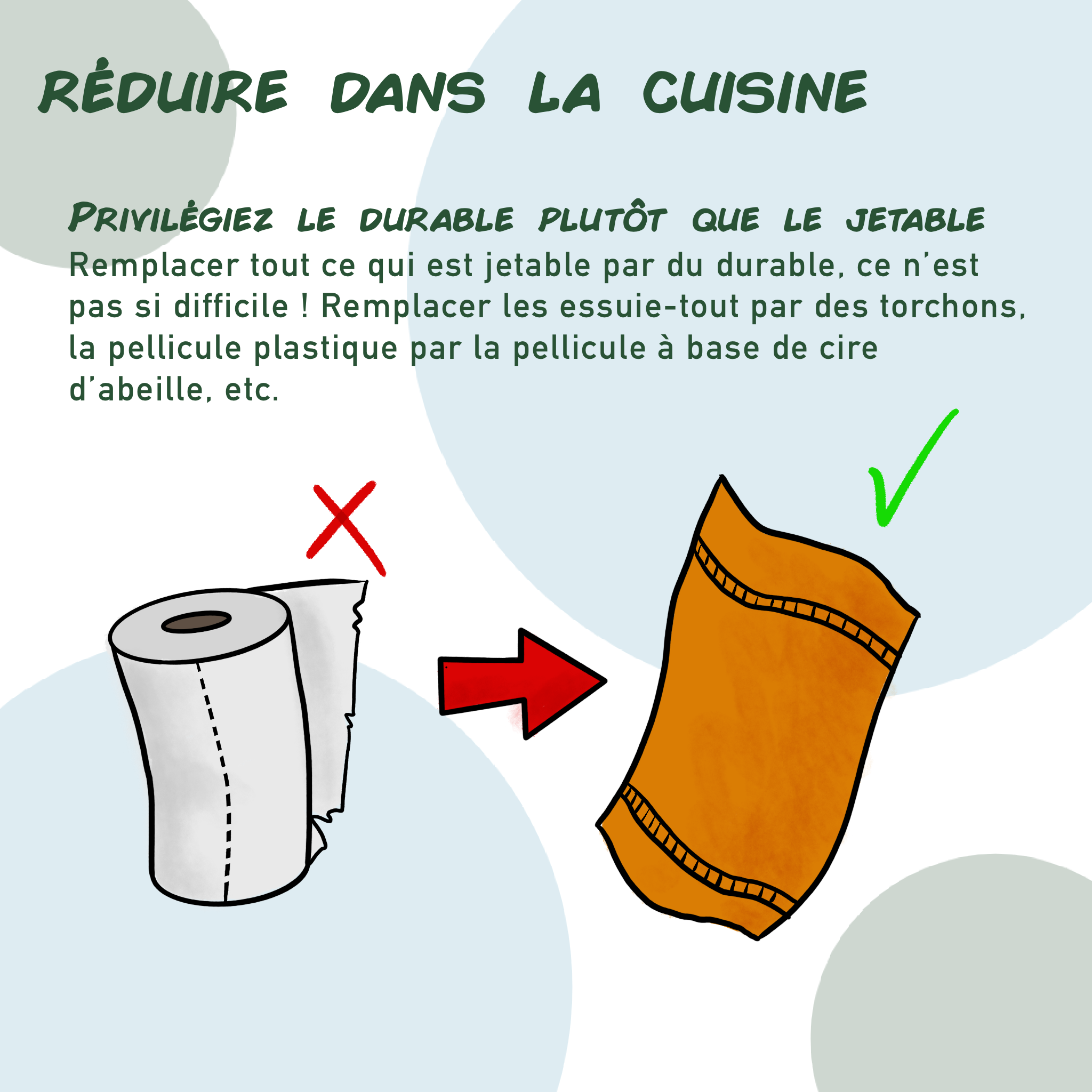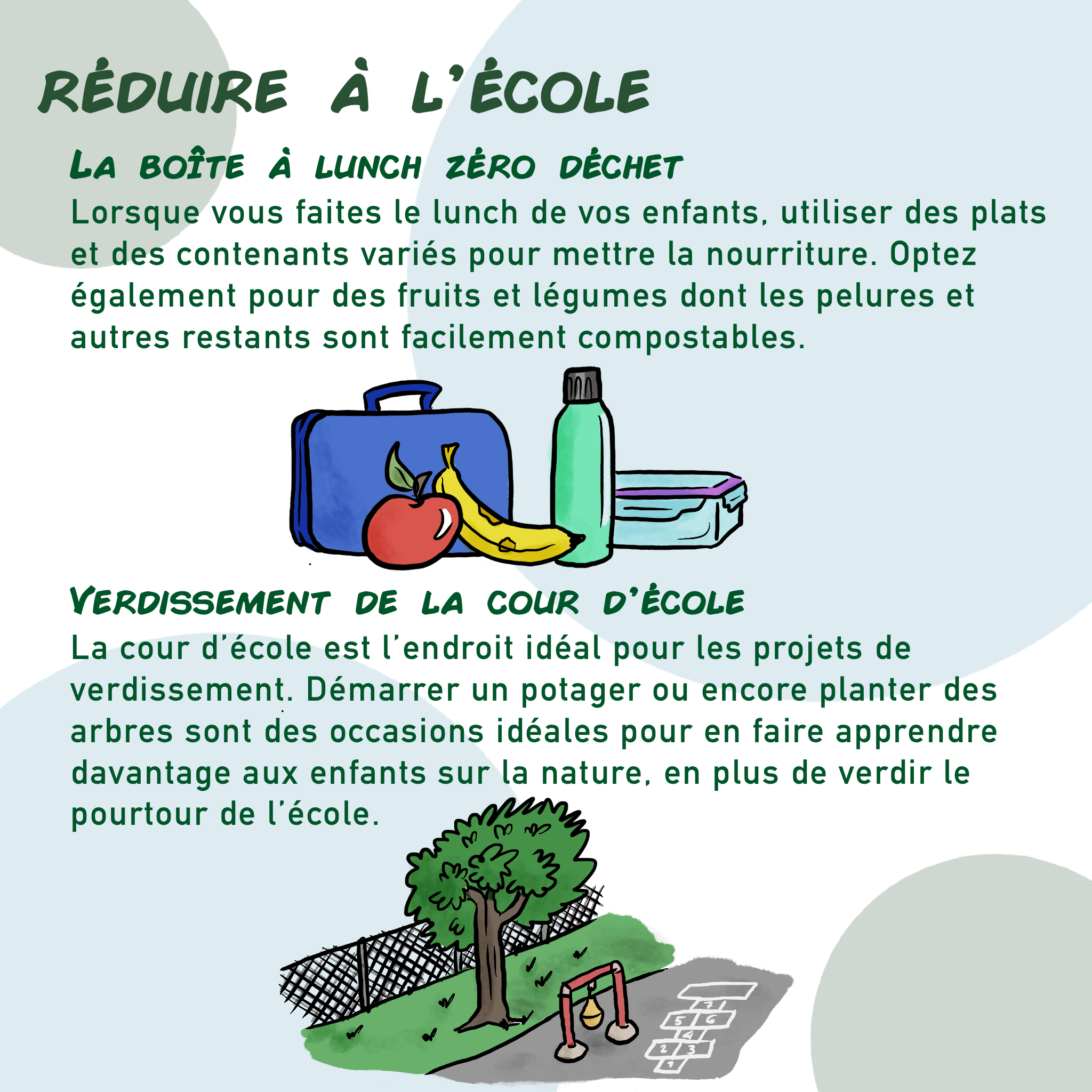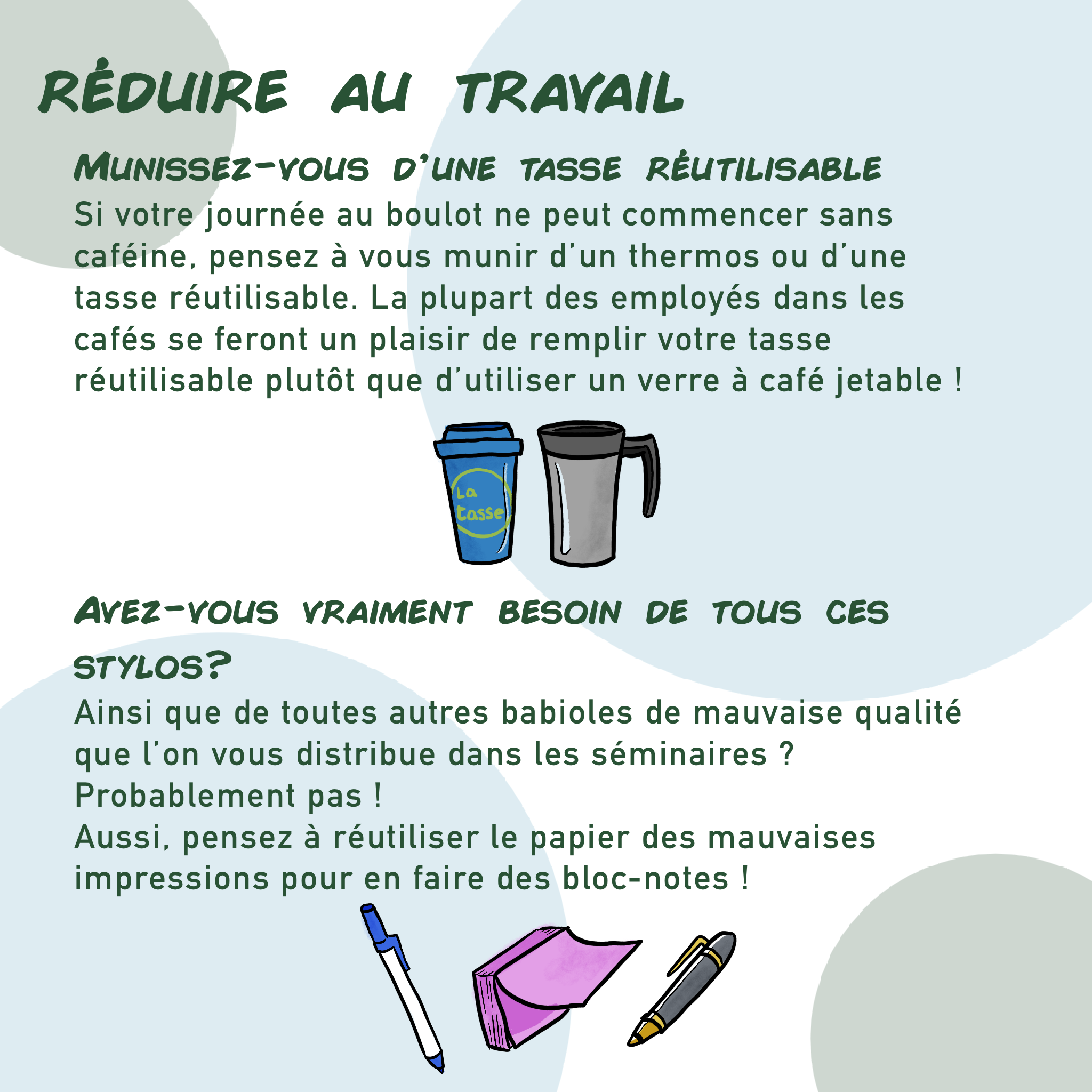Il était une fois une coopérative de solidarité Éconord qui était gestionnaire du programme Éco-quartier depuis 2012. Les employé.e.s de la coopérative de solidarité travaillaient à réaliser sa mission avec les citoyen.ne.s et ses partenaires tou.te.s ancré.e.s dans leur communauté.
La coopérative de solidarité Éconord rejoint la population avec une approche rassembleuse. En tant que porteuse du programme Éco-quartier, depuis déjà onze ans, la coopérative a su tisser des liens avec les citoyen.ne.s et des partenaires. Son expertise des 3RV (réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation) lui permet de bien informer la population. Compte-tenu des compétences acquises au cours des années, ne serait-il pas plus pertinent de retenir son approche communautaire plutôt que de miser sur la remise ponctuelle de rapports ?
Le programme Éco-quartier a été créé en 1993 et est porté par le Regroupement des éco-quartiers (REQ).
Une directrice d’organisme devrait pouvoir accompagner et soutenir ses employé.e.s au lieu de produire de nombreux rapports surtout quand lesdits employé.e.s travaillent ardemment à réaliser les tâches relativement aux mandats et objectifs de la mission du Regroupement des éco-quartiers.
Oublier tout l’investissement des employé.e.s dans l’accomplissement des mandats exigés dans le programme Éco-quartier, nous semble difficile à accepter.
Est-ce par une guéguerre de pouvoir ou par favoritisme caché que les répondants de l’arrondissement, s’érigeant en technocrates, font de l’ingérence et s’approprient des mandats ? Relégués à des rôles de simples exécutants et faisant face à des objectifs ainsi désincarnés, les employé.e.s, riche amalgame de talents, de compétences et de créativité, continuent d’œuvrer au quotidien à un objectif planétaire. Jamais, on ne parlera trop de leur dévouement et de leur engagement comme peuvent le démontrer le nombre élevé d’heures supplémentaires non rémunérées, la participation à des activités de leurs partenaires, les réponses spontanées aux besoins de citoyen.ne.s, etc. À bout de souffle, mais croyant à l’importance de la mission, ces employé.e.s persévèrent malgré tout.
Pour les trois prochaines années, le plan d’action de l’arrondissement exige davantage de la part des employé.e.s avec des mandats élargis sans augmentation du nombre d’employé.e.s et sans revoir les salaires.
La reddition de nombreux rapports demandés par l’arrondissement ne sert guère la gent Nord-Montréalaise qui a plutôt besoin d’une main et d’aide concrète pour comprendre la gestion des matières résiduelles ainsi que plusieurs autres enjeux environnementaux. Qui connait mieux le tissu social et est plus proche des citoyen.ne.s qu’un organisme installé dans le milieu qu’il dessert ? Nul doute que cette entité de proximité, de partage et de transmission est des plus appropriées pour motiver les citoyen.ne.s à poser des actions personnelles qui peuvent faire la différence dans la lutte à la pollution, et ce, grâce à des liens créés au fil des années.
Constat accablant : la mort programmée, par un arrondissement, du porteur du programme Éco-quartier provoquerait un effritement d’expertise, serait dommageable pour le milieu et, globalement, s’avérerait fort inquiétante et très dangereuse pour la démocratie participative des citoyen.ne.s.
Écrit par Diane Delisle et Diane Morin au nom du CA de la coop de solidarité Éconord.